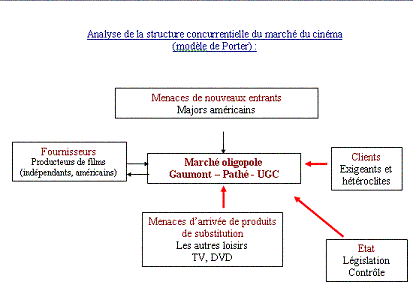1. Les publics
Alors que les loisirs culturels et plus traditionnels semblent en général moins attractifs, le Cinéma bénéficiant d'une image plus populaire semble tirer son épingle du jeu.
Cependant le marché français du cinéma suit la tendance générale du marché européen marqué par un déclin continu de ses activités mis en péril par l'arrivée des groupes américains. De plus la fréquentation des salles est en recul. Une baisse qui atteint en 2003 5.6% par rapport à 2002. Cette baisse s'explique par un prix du billet de plus en plus élevé et un public qui se réduit à des consommateurs majoritairement urbains (2/3 habitent des villes de plus de 100 000 habitants), jeunes (45% des entrées sont des moins de 25 ans) et aisés (45% des entrées sont des cadres). Cette cible sur-consommatrice dans les secteurs de la technologie, de la culture et du luxe, regarde moins la télévision.
2. Les professionnels
Le paradoxe du Cinéma est qu'il est à la fois un art et une industrie. Le contexte économique le pousse de plus en plus dans l'air de l'industrie (copie du système américain) qui s'appuie sur 3 segments d'activités principaux que sont la production, la distribution et l'exploitation de salles avec un objectif de concentration. Le marché cinématographique français est un marché oligopole disputé par 3 géants : Gaumont, Pathé et UGC.
Depuis 1982, le cinéma français a entrepris une politique de qualité dans sa production de films ainsi que dans la modernisation de ses salles. Avec notamment la création de complexes multisalles UGC et Gaumont. Néanmoins, l'essor de ces multiplexes suscitent une mobilisation de la part des professionnels (les exploitants indépendants). En effet, un collectif régional anti-multiplexe réclame «l'arrêt de la prolifération des multiplexes, en attendant la mise en place d'un schéma régional et d'équipement cinématographique. »
De plus le score de la production française a du mal a résister à la production américaine. Pourtant la situation du cinéma en France reste privilégiée en comparaison aux voisins européens. Le marché français du cinéma est atypique car il est soutenu par les pouvoirs publics et le CNC (Centre National de la Cinématographie). La politique de défense et de développement de l'industrie cinématographique passe notamment par la taxation de 11 % du prix du billet afin d'aider la création et la diffusion des films français. C'est ce qu'on appelle «l'exception française » (par exemple le Festival de Cannes est le seul festival organisé par un Etat).
Depuis 2000 de sérieuses interrogations se posent quant à l'avenir du cinéma français et de son système protectionniste. La politique de concentration n'a jamais été aussi intensifiée. En effet de nombreuses fusions ont été conclues, des alliances se sont constituées et l'arrivée de nouveaux concepts de fidélisation du client transforment considérablement le paysage cinématographique français. L'un des grands bouleversements fut la création de Vivendi Universal, résultat de la fusion de Vivendi, Canal+ et Universal. Vivendi Universal s'est associée à un major de l'entertainment basée aux Etats-Unis. Le groupe propriétaire de Canal+ a accepté de voir son capital passer à hauteur de 54 % dans les mains d'actionnaires étrangers, notamment des fonds de pension anglo-saxons. La chaîne cryptée, qui a financé 70 % des films français en 2000, se trouve désormais franchisée au sein de cette nouvelle entité et n'assume plus ses obligations vis à vis de l'Etat et du Cinéma français (9% de son chiffre d'affaires doit servir pour investir au préachat de droit de diffusion de films français).
Ainsi alors que la fréquentation des salles diminue, que la production française est mise en péril et que le cadre législatif évolue en leur défaveur, les deux poids lourds de l'hexagone, Gaumont et UGC se battent sur tous les fronts du «cinéma business ».